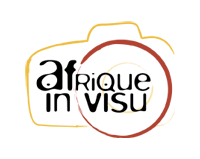Lauréate du Prix Canon de la Femme Photojournaliste en 2010, la jeune photographe italienne Martina Bacigalupo expose à Perpignan le travail réalisé grâce à ce prix. « Mon nom est Filda Adoch » raconte l’histoire d’une femme Ougandaise de 53 ans dont la vie a été bouleversée par la guerre. Plus que la violence et les drames, Martina s’intéresse aux gestes quotidiens et à la résistance silencieuse de cette véritable guerrière de l’ordinaire.
Martina, vous êtes née à Gênes, en Italie en 1978. Après avoir étudié la photographie en Angleterre au London College of Printing et avoir assisté la photographe Giorgia Fioro à Paris pendant quelques temps, vous partez au Burundi comme volontaire des Nations Unies en tant que photographe . Vous y poursuivez depuis votre travail de photojournaliste en collaborant notamment avec plusieurs ONG internationales implantées localement telles que Human Rights Watch, Handicap International et CARE. Vous avez aussi rejoint l’agence Vu en avril 2010. Pourquoi être restée au Burundi ? 
Ca peut être stratégique aujourd’hui pour un photojournaliste d’être basé en Afrique, pour vendre ses photos, pour faire ses reportages…
Pas du tout, l’Afrique ne se vend pas du tout, le noir et blanc, encore moins. Donc faire du noir et blanc en Afrique ce n’est pas cela qui te fera gagner de l’argent. C’est un choix de vie: aller creuser une culture que l’on ne connait pas. La région des Grands Lacs est immense, avec des pays qui sont différents mais qui ont aussi des liens très proches. C’est une zone à la fois très belle, très violente et très accueillante. Il y a tellement de contradictions. C’est très intense.
En 2010 vous avez remporté le prix Canon de la Femme Photojournaliste. Cette année vous présentez à Visa pour l’image le travail effectué grâce à ce prix qui s’intitule « Mon Nom est Filda Adoch » A travers 35 photographies en noir et blanc vous racontez l’histoire de Filda, une femme Ougandaise de 53 ans qui vit dans le district de Gulu dans le nord du pays, et dont la vie a été particulièrement marquée par la guerre qui oppose le gouvernement de Museveni et l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA). Pouvez-vous retracer en quelques mots la vie de Filda et nous raconter votre rencontre avec elle ?
Filda est un peu le symbole de l’histoire des 20 dernières années de guerre au Nord Ouganda. Elle a perdu son premier mari, qui a été tué par l’armée qui pensait que c’était un rebelle. Elle s’est remariée et son deuxième mari a été tué par les rebelles. Elle a perdu une jambe sur une mine antipersonnel. Elle a perdu un enfant dans une embuscade des rebelles alors qu’il allait chercher les résultats de ses examens à l’école. Elle a aussi attrapé le SIDA par son deuxième mari. Et aujourd’hui elle s’occupe de 18 personnes. C’est une femme d’une force extraordinaire.
Quand Human Rights Watch m’a appelée pour que je fasse les photos pour un rapport sur les femmes au Nord Ouganda, j’ai rencontré de nombreuses femmes chaque jour. J’ai demandé à passer une journée entière avec l’une d’entre elles. Travailler en ayant que quelques minutes ne me permettait pas de me rapprocher d’elles. Je sentais que c’était un peu violent pour moi et pour elles. J’ai lu les interviews que Human Rights Watch avait fait des différentes femmes, et toutes les histoires étaient fortes, du coup j’ai choisi par rapport à ma sensation. Quand j’ai rencontré Filda, je me suis dit : « c’est elle ». Ce qui m’a touché chez elle c’est qu’elle a tout pour être une victime, mais elle ne l’est pas. Avec tout ce qu’elle a vécu et tout ce qu’elle endure chaque jour, elle ne demande rien à personne, elle mène sa vie. Pour moi c’est quelque chose qui peut nous toucher tous. L’Afrique, ce n’est pas de la misère, c’est de la lumière!

La distance physique à laquelle vous travaillez est respectueuse et discrète, presque délicate, pourtant on sent entre vous et votre sujet une grande complicité, beaucoup de confiance, de l’admiration, peut-être même de l’amitié, comme si la photo n’était qu’accessoire aux moments partagés. Parlez nous de votre relation à la photographie et à vos sujets.
Le centre, c’est la relation. La photographie c’est une excuse mais c’est une excuse qui m’amuse. C’est une écriture qui m’intéresse, un moyen d’expression et de dénonciation, c’est un lieu de réflexion, de questionnement, donc je ne veux pas minimiser son importance. Mais c’est évident que sans la relation il n’y a rien. C’est pour ça que j’ai choisi ce métier, pour les rencontres.
L’exposition est finalement un travail à quatre mains, avec d’un coté vos photographies et de l’autre les «légendes » qui sont en fait les commentaires de Filda elle-même sur vos photos. Vous aviez envie de lui donner sa propre voix sur votre travail ?
Tout a fait. L’idée à la base c’était d’écrire cette histoire à deux. Puisque je vis la bas, je vois assez souvent l’agressivité avec laquelle on se présente parfois devant les situations si différentes de nous. Soit on les idéalise, soit on les juge mais on ne se met jamais dans un rapport équitable, sur le même plan. C’est difficile de trouver un rapport d’homme à homme. Si on arrive à juste se mettre devant une autre personne et se dire, moi je peux te donner ça, et toi tu peux me donner ça et ensemble on peut faire quelque chose qui n’existait pas avant, je pense que c’est la juste mesure. Filda s’amuse à regarder les images, et elle profite du fait que j’ai fait ces images pour donner ses commentaires. Sans ces images elle n’aurait pas pu faire ces commentaires et moi sans ses commentaires je n’aurais pas pu faire ces images. On a vraiment essayé de trouver le juste lieu de rencontre entre deux mondes si différents qui doivent s’assumer, assumer leur propre identité et puis se réunir.
C’est très intéressant de voir que ses commentaires concernent principalement son travail, sa force physique et la fierté qu’elle a d’accomplir ses tâches malgré son handicap. Dans l’une de vos photos, on voit Filda sur le chemin du retour après la collecte du bois, et les branches qu’elle porte sur la tête forment une coiffe extraordinaire. La légende de Filda dit: « on dirait que j’ai des ailes sur la tête et que je vole à travers le ciel ». Est-ce le regard que vous portez sur elle qui lui « donne des ailes » ?
(Elle rit) Je pense qu’elle en tant qu’être humain m’inspire des choses et moi je traduis cela en image et elle transforme à son tour cette image en quelque chose pour elle. Il y a vraiment un mouvement de va et vient entre nous deux. Elle s’amusait, elle rigolait en regardant les images. Il n’y a pas de miroir chez elle et donc elle s’observe dans mes photos. Comme quand elle dit « Il est fort mon dos », elle n’a jamais vu son dos avant…

Les seules photos désincarnées que vous présentez dans cette exposition sont des paysages qui sont en fait les photographies des lieux des drames de la vie de Filda : la tombe de son fils, la route sur laquelle il a été tué, le camp de déplacés de Bobi où elle s’est réfugiée pour fuir les violences, et enfin le chemin où elle a perdu sa jambe en marchant sur une mine alors qu’elle se rendait aux champs. Vous avez choisi de représentez ces images floues comme pour retransmettre la violence du choc, et de la douleur…
Je suis pas sûre que ce soit un choix, c’est peut-être inconscient. Ce sont des lieux de son passé, des lieux de la mémoire. Les souvenirs sont toujours très précis et en même temps très flous. On n’arrive pas à les saisir. Je crois qu’il y a un peu ça dans ces images. Ce sont des petits voyages dans sa mémoire.
Quand elle m’a parlé de la mort de son fils, qu’elle a pleuré devant moi, ça a créé une intimité entre nous. C’est comme si j’étais devenue la gardienne d’une mémoire très douloureuse et très précieuse en même temps. Il fallait que j’en prenne soin. Donc oui, j’ai essayé d’en parler avec discrétion, tout en parlant parce que c’est important de le raconter.
Le lieu où elle a perdu sa jambe est juste un petit chemin comme il y en a partout en Ouganda mais nous avons marché pendant une heure et demi sous le soleil pour aller retrouver cet endroit. Elle a dû chercher car ça faisait peut-être quinze ans qu’elle n’était pas retournée là bas. Quand on l’a trouvé, elle m’a raconté toute l’histoire et j’ai pris cette photo. Le lendemain elle m’a dit : « je suis contente d’y être retournée avec toi. J’avais peur de marcher encore sur une mine dans ce champ. Maintenant que j’ai remarché là bas, je sais que je pourrai marcher partout. » Ca m’a frappée, je n’avais pas anticipé une telle réaction. C’est comme si ça l’avait aidé à faire le deuil quelque part. L’image, et même avant l’image, la démarche d’être retournée là bas, de montrer cet endroit, ça l’a aidée à s’apaiser.
L’exposition se termine par une série très mystérieuse, presque magique de photographies prises de nuit et où les visages se distinguent à peine à la lumière du ciel étoilé, et où les silhouettes se font confuses lors de danses traditionnelles autour du feu. Qu’apporte cette série à votre portrait de Filda ?
Pour moi ces photographies sont essentielles. C’est là que j’ai vraiment connu Filda et l’essence de l’identité de sa communauté. Elle m’a dit que la première chose qu’elle avait faite quand elle a quitté le camp de déplacés pour retourner dans son village était de faire le feu. Dans le camp, les maisons sont si rapprochées qu’elle ne pouvait pas faire un feu car tout brûle tout de suite. Le feu, c’est le centre de la culture Acholi. C’est autour du feu que les enfants apprennent les danses pour les événements importants de la communauté : les naissances, les deuils, les mariages, l’arrivée du roi, l’accueil de l’étranger, même l’amour ! On rencontre son compagnon autour du feu à travers la danse. La danse est vraiment un langage. Les enfants y apprennent leur histoire et leur mythologie, ils apprennent la signification de leur culture. A travers des devinettes que les vieux posent aux enfants, ils apprennent à interpréter les événements de la vie. C’est leur école, là où ils se forment en tant qu’Acholi, en tant qu’être humains. Donc tu vois comment la guerre peut détruire l’identité d’un peuple et comment des personnes comme Filda qui sont conscientes de l’importance des traditions, les reprennent, des années plus tard, dès leur retour au village. Dans la nuit, il y a une véritable réappropriation de son identité, une espèce de recharge d’énergie pour faire face.

Par le passé vous avez aidé certains de vos sujets. Je pense à Francine, une autre femme burundaise, sujet central d’un de vos précédents reportages et à qui son beau-frère avait coupé les bras. Vous l‘avez fait venir en Italie l’année dernière pour lui faire faire des prothèses. Est-ce que vous envisagez de faire la même chose pour Filda ?
Filda a eu une partie du prix. J’ai senti que c’était juste de lui reverser. Elle en a besoin, elle a 18 personnes à sa charge et n’a rien eu jusqu’à présent. Dans une relation à deux on ne peut pas ouvrir les yeux sur les choses qui nous intéressent et les fermer sur d’autres. Chaque relation a son histoire. Je pense que la photo ne suffit pas. On est une personne avant d’être un photographe. Et je suis devant un être humain avant d’être devant un sujet.
Vous êtes une jeune femme et une relativement jeune photographe. Vous avez adopté une approche particulièrement sensible avec le temps et l’investissement émotionnel que cela implique. Comment vous sentez- vous à Visa pour l’Image, parmi les reporters et les reportages de crises, de guerre, de catastrophes naturelles ?
Je suis très reconnaissante envers Jean- François Leroy (Directeur de Visa pour l’image) de m’avoir donné la possibilité d’exposer et d’avoir accepté de montrer ce travail qui ne correspond pas à l’actualité du jour, ni comme sujet, ni comme approche. Pour moi, tous les moyens de raconter une histoire sont justes, je ne me pose pas de limites. Il se passe de beaux échanges à Visa, je ne me sens pas du tout à l’écart, les gens sont sensibles à mon travail, sensibles à une approche différente, à une autre façon de raconter une histoire.
Avez-vous de nouveaux projets pour la fin de 2011 et pour 2012 ?
Récemment j’ai ramassé dans la poubelle d’un studio de photo toute une série de restes de photos d’identité qui ont été découpées. Dans ce studio, ils n’ont pas de machine spéciale pour faire les photos de passeports, donc ils prennent toute la photo pour ne garder que la tête et ils jettent le reste. Tout ce qui est autour c’est le plus beau ! J’ai pris tout le tas ! Pour moi c’est magnifique parce qu’il y a une spontanéité dans les gestes, dans les habits, dans les positions. On voit tout ce qui est autour et qui n’est pas contrôlé parce que seul le visage va rester sur la photo. La photo, c’est choisir un cadre et proposer ce cadre. Là, on voit tout ce qui est en dehors du cadre. Alors qu’est-ce qui est le plus vrai, ce qu’il y a dedans ou ce qu’il y a dehors ? C’est un projet à long terme que je vais continuer, c’est une façon différente de raconter l’Afrique. Il est temps de raconter quelque chose d’autre de l’Afrique. On perd trop de vue ce qu’elle peut nous apporter. Ce projet me donne la possibilité de donner un visage plus juste à l’Afrique.